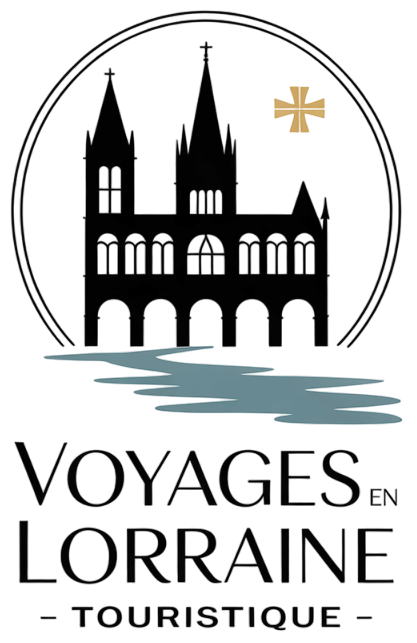Une frontière mouvante : Alsace et Vosges, jeux d’influence sur le patrimoine
Entre Lorraine et Alsace, la crête des Vosges n’a cessé de sculpter des destins partagés et un patrimoine métissé.
L’architecture s’en ressent : maisons à pans de bois du Grand Est voisinent avec les fermes-blocs vosgiennes et les oriels alsaciens.
Le bilinguisme occitan-germanique perdure dans la toponymie, les traditions de marcairies (fermes d’estive), et jusque dans la gastronomie (munster, kirsch, baeckeoffe).
Le passage de la frontière franco-allemande sur la crête (1871-1918) a laissé des marques : blockhaus, poteaux frontières encore visibles dans le Haut-Rhin, et présence de cimetières militaires mixtes (source : ICRC).
Cette identité plurielle imprègne l’imaginaire régional, que l’on soit dans l’accueil chaleureux des marcaires ou dans la diversité du folklore, jusqu’aux costumes traditionnels où le rouge alsacien répond au bleu lorrain.