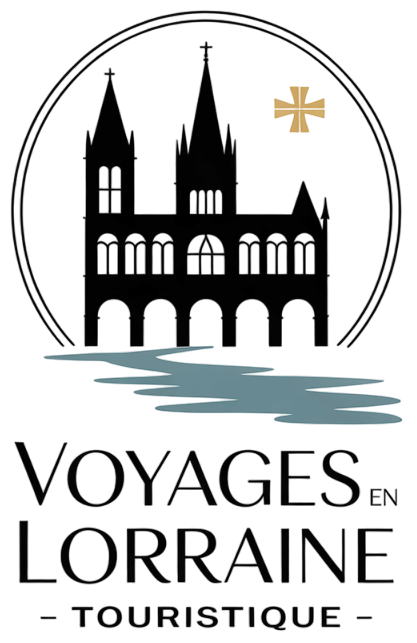La Meuse, artère de la métallurgie lorraine
L’eau et les forêts : des atouts naturels
Ce n’est pas un hasard si les seigneuries et abbayes installèrent dès le Moyen Âge, sur les rives de la Meuse et de ses affluents, des martineries, des forges et des moulins à eau. L’eau abondante, la proximité des vastes forêts (source de charbon de bois), et un sous-sol généreux en minerai de fer ont favorisé le développement, dès le XIII siècle, d’une métallurgie florissante. Les sites de Vaucouleurs, Dommary-Baroncourt, Saulcy-sur-Meurthe ou Stenay deviennent, entre le XVe et le XVIIIe siècle, des centres actifs d’affinage et de forge. La renommée des forges de la Meuse s’étendait jadis jusqu’en Champagne, en Bourgogne et au-delà.
Du fer des bocages au canon de Verdun
Lorsque la Révolution industrielle s'amorce au XIX siècle, la Meuse se positionne rapidement comme un maillon clé. On estime qu’à la fin du XIXe siècle, le département de la Meuse comptait encore plus de 120 établissements sidérurgiques et métallurgiques (source : Lorraine Industrielle, Presses Universitaires de Nancy). Ici sont produits rails, outillages agricoles, constructions, ustensiles domestiques, mais aussi pièces d’artillerie — la fonderie de Broussey-Raulecourt configure par exemple des canons pour le front de Verdun durant la Grande Guerre.
Verdun, meurtrie lors de la Première Guerre mondiale, doit une part de sa reconstruction aux forges et ateliers de la région. L’industrie métallurgique recule au XXe siècle, mais des entreprises comme Forges de l’Est ou SAFRAN (à Commercy) perpétuent l’héritage, adaptant savoir-faire traditionnel et hautes technologies.