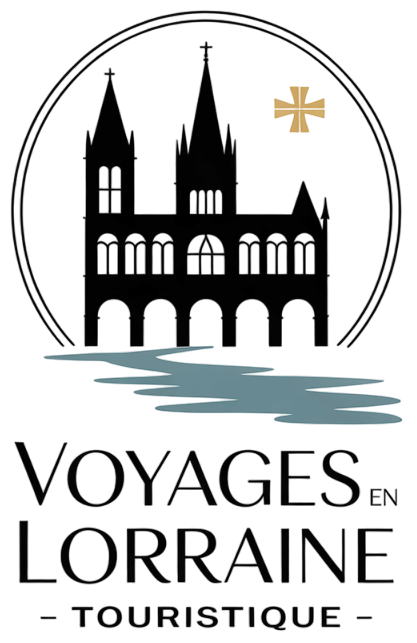Monuments survivants : abbayes, prieurés et ruines majeures
L’abbaye bénédictine de Saint-Mihiel : l’art roman au cœur de la vallée de la Meuse
Fondée autour de 708 par saint Hidulphe, l’abbaye Saint-Michel de Saint-Mihiel demeure l’un des témoins les plus éloquents de la puissance monastique meusienne. D’abord bénédictine, elle sera un centre intellectuel et artistique majeur durant plus de mille ans. L’abbatiale actuelle, reconstruite entre le XI et le XIII siècle, conserve la sobriété romane, mais déploie aussi une richesse Renaissance, notamment dans son mobilier et sa fameuse statue de la Pâmoison de la Vierge par Ligier Richier. Près de 1 000 manuscrits et incunables y furent produits ou conservés, dont une partie, rescapée des destructions, est visible à la bibliothèque bénédictine, classée Monument Historique depuis 1971.
L’abbaye d’Evaux (Évaux-en-Barrois) : ruines en forêt, mémoire des cisterciens
Plus secrète, l’ancienne abbaye cistercienne d’Évaux, fondée en 1146 par des disciples de saint Bernard, se niche dans l’ombre des bois. Victime de la Révolution et du temps, elle n’offre aujourd’hui que des vestiges émouvants : pans de murs envahis par le lierre, bases d’ogives et croisée de transept, et une ferme monastique transformée en exploitation agricole. Ce lieu isolé, facilement accessible par le sentier balisé du GR 714, attire autant les amoureux d’histoire que les rêveurs.
(Source : Base Mérimée - Ministère de la culture)
L’abbaye de Beaulieu-en-Argonne : relique cistercienne et havre de paix
Dans la forêt de Beaulieu, à une vingtaine de kilomètres de Sainte-Menehould, l’abbaye cistercienne fondée en 1127 s’élève encore, telle une invitation à la contemplation : quelques murs de l’église abbatiale, le réfectoire, un fragment du cloître. L’ancien logis abbatial, devenu aujourd’hui un gîte rural, rappelle la capacité du patrimoine monastique à réinventer sa vocation et à dialoguer discrètement avec le tissu rural.
(Argonne Tourisme)
Saint-Airy et Montiers-sur-Saulx : souvenirs de bénédictins et d’art gothique rural
Le village de Saint-Airy conserve l’église de son ancien prieuré du XIII siècle, admirablement restaurée, d’une architecture gothique dépouillée qui traduit la spiritualité des temps médiévaux. À Montiers-sur-Saulx, c’est l’église paroissiale, élevée sur les restes d’un prieuré bénédictin fondé avant 1090, qui se distingue par son portail roman et ses vitraux contemporains.