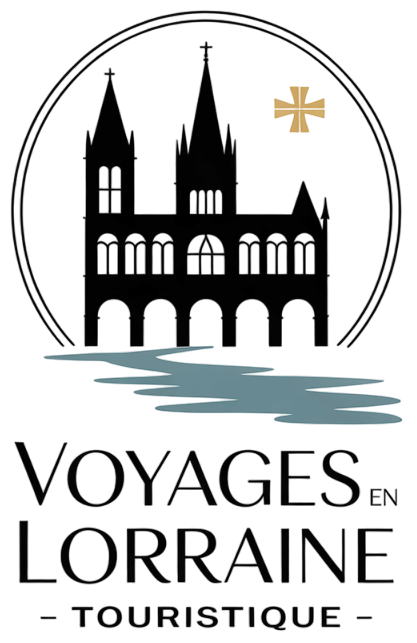La Moselle et l’identité plurielle : un héritage vivant
La Moselle a longtemps été à la croisée des influences, tour à tour française, allemande, cosmopolite. L’industrie a été un puissant moteur d’intégration, attirant des travailleurs d’Europe centrale, d’Italie, du Maghreb : un brassage qui imprime sa marque jusque dans les accents, la cuisine, les associations, les patronymes gravés sur les monuments aux morts.
Le sentiment d’appartenance à la « région du fer » transcende parfois la seule identité locale. On célèbre encore aujourd’hui les fêtes des corporations, la Sainte-Barbe chez les mineurs, Saint-Eloi chez les métallos. Cette transmission s’exprime dans l’art populaire, les fanfares, les chorales, dans les stèles funéraires ornées de marteaux ou de roues dentées.