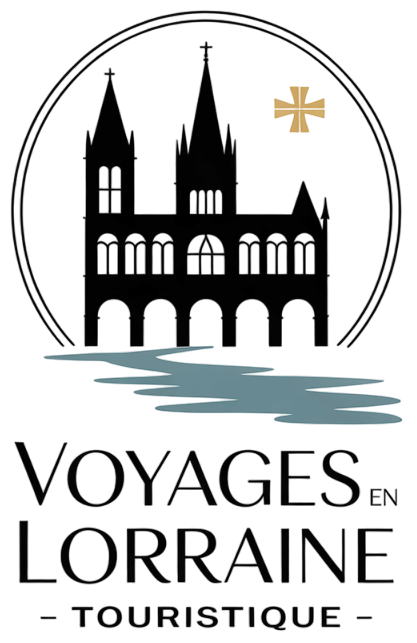Du XIX au XXI siècle : essor, emprises nouvelles et fractures
Le XIX siècle est celui de la “revanche catholique” mais aussi du retour en force des congrégations féminines, masculines, enseignantes et soignantes : Sœurs de Saint-Charles (fondées à Nancy, relais très actif en Moselle), Franciscaines, Marianistes, Salésiennes, etc. Elles développent écoles, hospices et orphelinats, notamment après le rattachement du département à l’Empire Allemand (1871-1918).
- Metz accueille, en 1881, la grande synagogue classée aujourd’hui Monument Historique : un des plus beaux temples israélites de France (France 3 Grand Est, 2023).
- La Moselle voit naître, entre 1872 et 1914, une trentaine de couvents et maisons religieuses nouvelles, dont plusieurs subsistent aujourd’hui transformés en logements, écoles ou lieux associatifs.
- Le protestantisme germanique connaît alors une certaine renaissance, notamment dans l’Est du département et à Forbach, Stiring-Wendel, Sarreguemines.
Les décennies 1930-1940, marquées par l’Occupation, voient le drame de la Shoah marquer des villages entiers : sur les 17 000 juifs recensés en Moselle en 1940, plus de 3 000 périront en déportation. Après-guerre, la majorité des communautés protestantes et juives connaissent une érosion constante (sources : Juifs en Moselle, Wikipédia, Dossier familial).
À cette histoire plurielle s’ajoutent, depuis la fin du XX siècle, les nouveaux visages religieux de la Moselle urbaine : mosquées, lieux de culte protestants évangéliques, temples bouddhistes (impulsés par la diaspora vietnamienne notamment), associations interreligieuses… La carte spirituelle continue d’évoluer, au rythme des migrations, de la déprise rurale, des reconversions de patrimoines.