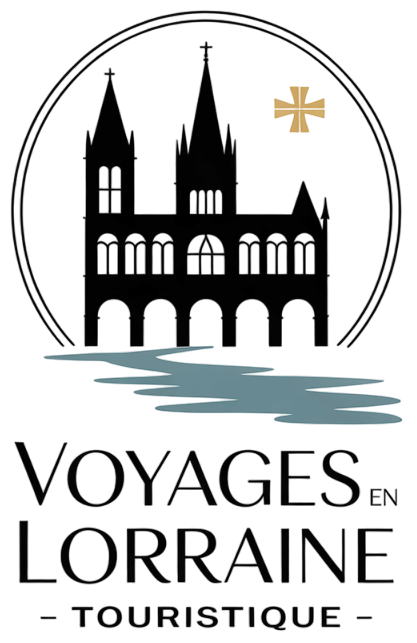Les grandes abbayes monastiques : foyers spirituels et artistiques
L’abbaye d’Étival : la « Sénatorie » des Vosges
Fondée au VII siècle, l’abbaye d’Étival, « Sanktivallis » dans les textes médiévaux, se dresse au sud-ouest de Saint-Dié. Tour à tour bénédictine puis prémontrée, elle fut longtemps qualifiée de « sénatorie », c’est-à-dire centre spirituel d’importance comparable à celles de Remiremont ou Moyenmoutier, dans le réseau des abbayes vosgiennes (source : Annales de l’Est).
L’église abbatiale, chef-d'œuvre du roman vosgien (XII siècle), se distingue par la pureté de son chevet, ses chapiteaux sculptés, la sobriété de ses lignes et son jeu de lumière à travers la pierre claire. Longtemps, Étival régula la vie rurale et fut un foyer de manuscrits et d’enluminures connu jusqu’au sein de l’Empire. Son trésor, dispersé à la Révolution, laisse toujours apparaître un fragment de la célèbre tapisserie « de Saint-Hubert » du XIV siècle, visible aujourd’hui à Épinal.
Remiremont, la cité des chanoinesses et ses privilèges
Enclavée sur les rives de la Moselle, l’abbaye de Remiremont fut initialement un monastère double, fondé en 620 : moines et moniales cohabitaient selon la règle de saint Colomban. Elle devint vite un chapitre noble, exclusivement féminin : celui des chanoinesses séculières, issues des grandes familles d’Europe, investies d’un pouvoir non négligeable. Jusqu’à la Révolution, ces femmes géraient terres et revenus, élisaient leur abbesse et étaient parfois exemptées d’obligation de vœu de pauvreté, une singularité dans l’échiquier religieux (source : Églises et abbayes de Lorraine, Serge Domini, 2015).
- L’actuelle église abbatiale, à la silhouette massive, s'accompagne encore des bâtiments du cloître et de traces d’un passé prestigieux : salle du chapitre, orgues classées, chapelle du Saint-Esprit.
- L’abbatiale a accueilli une des rares processions du Saint-Sacrement autorisées par l’Église à se dérouler en dehors du chœur, privilège réservé à une poignée de fondations impériales.
Moyenmoutier : la pierre et la réforme
Fondée vers 671 par saint Hydulphe, Moyenmoutier fut l’un des points stratégiques du renouveau monastique lorrain : siège de la « réforme de Lorraine » au XVIIe siècle, aux côtés de Saint-Vanne (Metz) et de Saint-Évre, elle influença la spiritualité et l’organisation des monastères bien au-delà des Vosges (voir : Wikipédia - Réforme de Lorraine).
Les bâtiments, remontés après les guerres de Religion, frappent par leur monumentalité : nef majestueuse (63 m de long), grand chœur, orgue monumental, cloître. Un manuscrit précieux intitulé Chronicon Mediani Monasterii y fut rédigé, relatant les heurs et malheurs du lieu du haut Moyen Âge à la Renaissance.