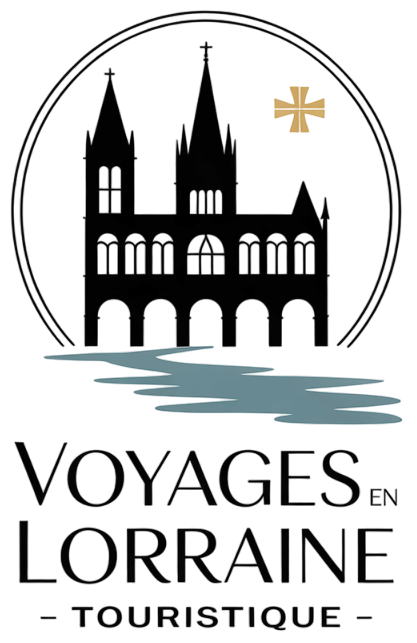Des anecdotes qui marquent : stations, célébrités et petites histoires
Les stations vosgiennes doivent leur éclat à d’illustres visiteurs : Napoléon III fit de Plombières un laboratoire social, où furent négociés les accords secrets entre la France et le Piémont. Là, Stendhal corrigea des pages de La Chartreuse de Parme, et Lamartine déclama, sous la verrière de l’ancien Palmarium, des vers nostalgiques.
À Vittel, c’est l’aventure industrielle qui marque les esprits : dès 1885, Louis Bouloumié achète la source et fonde la station. L’eau devient rapidement le symbole d’une Lorraine moderne, tournée vers la santé, l’ingénierie et le progrès. Ce modèle attire sportifs et curistes de toute l’Europe, comme en témoigne la construction du stade olympique et de la piscine Art déco (1926), chef-d’œuvre du béton armé.
Dans les années 1930, les stations accueillent également des congrès, des concerts, des salons littéraires et même des compétitions de courses hippiques et cyclistes (Vittel devient ainsi une ville-étape du Tour de France dès 1968 : Le Tour).
Le patrimoine thermal, c’est donc aussi une aventure humaine riche, parfois insolite, qui croise la grande histoire et le quotidien villageois.