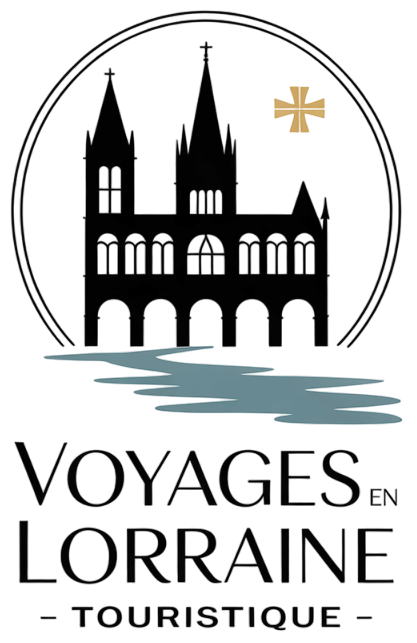Résistances, échanges, et influences alimentaires : le temps de la table
La gastronomie vosgienne, loin d’être fermée sur elle-même, s’est toujours enrichie de ses voisins alsaciens. On y trouve, notamment, le goût des fermentations, des charcuteries, et la prédilection pour le chou, héritée de l'Alsace protestante. Le fromage de Munster lui-même — dont la dénomination s’étend sur les deux versants du massif —, est un emblème du partage transfrontalier.
- Le “sürkrüt” – la choucroute – fait partie intégrante de nombreux menus dans les vallées vosgiennes orientales, jusqu’à Gérardmer ou Cornimont.
- La fameuse tourte vosgienne fait écho à la flammekueche alsacienne, modulée par les ingrédients disponibles de part et d’autre de la montagne.
Ces influences s’observent aussi dans la tradition des marchés, notamment ceux d’automne, où se croisent producteurs vosgiens et marchands venus de la plaine d’Alsace. De nombreux villages côté vosgien étaient autrefois liés, pour leurs débouchés agricoles, aux villes alsaciennes proches, tel Saint-Dié-des-Vosges avec Sélestat ou Colmar. (Source : Encyclopédie de la Lorraine).